Les projets présentés dans l'exposition seront regroupés sous six thématiques qui serviront de cadre au débat lors des tables rondes. Cette classification n'a, en aucun cas, un caractère dogmatique ; les catégories élaborées ne sont pas étanches ; des glissements peuvent s'opérer de l'une à l'autre. C'est une grille de lecture qui est ici proposée ; elle tente de mettre en lumière des attitudes différentes face à l'architecture de l'habitation.
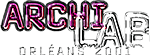
>>visite
en images de l'exposition
•1)
Individualiser l'habitat collectif
C'est une préoccupation devenue presque habituelle, une problématique
liée à la ville et aux lieux où l'espace est restreint.
La question se pose la plupart du temps en termes d'économie d'espace
; la réponse se traduit, le plus souvent, par une augmentation
de la densité. Comment augmenter la densité et prendre en
compte l'hétérogénéité des populations
? Comment garder une unité en termes de développement urbain
et préserver l'idée communautaire, en favorisant la diversité
des modes d'appropriation et en permettant leur évolution ? Comment
concilier l'espace public et la nécessité d'un espace identitaire
?
•2)
Flexibilité
La flexibilité est une thématique chère aux années
70. Trente ans après, cette préoccupation ressurgit, posée
en d'autres termes.
Le "do-it-yourself", la forme ouverte, dans laquelle le quotidien
se déploie au gré de l'usage, a remplacé "l'architecture
sans architecte".
"L'industrialisation du bâtiment" avait rendu possible
la conception de logements aux cloisons mobiles, permettant la polyvalence
des espaces.
Aujourd'hui, les modes de production industrialisés vont vers la
possibilité d'élaborer des propositions singulières
par l'assemblage, la combinatoire d'éléments modulaires
préfabriqués.
"La concertation avec les usagers", visant à prendre
en compte dans la conception les désirs individuels et collectifs,
a pris d'autres formes grâce aux nouvelles technologies de communication
qui permettent une réelle collaboration entre l'architecte et son
client.
•3)
Créer le paysage
Pour certains, la présence au lieu est fondamentale. Le paysage
devient un élément fédérateur entre l'architecture
et la nature. L'habitation appartient à son lieu d'implantation.
Elle s'enterre et devient paysage, intégrant le contexte ; elle
invente le paysage pour l'exalter, s'érigeant en rupture ou en
continuité avec lui.
Elle crée un autre territoire, ou se fait métaphore en mémoire
à des activités disparues.
•4)
Nouveaux styles de vie, aujourd'hui et demain
En réponse à l'émergence de nouveaux styles de vie
liés aux conditions d'existence, des stratégies de reprogrammation
se mettent en place, issues d'un réel quotidien, qui prend en compte
les usages, leur superposition, jusqu'à proposer une architecture
qui a valeur de fiction, d'anticipation.
Apparaît une conception non-standard de l'habitation, qui ne cherche
plus à transmettre ou exprimer des valeurs, mais satisfait aux
besoins actuels en même temps qu'elle est en mesure de s'adapter
à l'évolution de la vie.
Apparaissent également des formes nouvelles qui prétendent
répondre à un style de vie annoncé, nomade, déterritorialisé,
faisant de l'habitation une extension du corps, où l'espace est
optimisé et qui échappe au paysage naturel pour en reconstruire
un autre, virtuel et modulable, au gré de l'envie.
•5)
Subversion
Il faut l'entendre ici comme une attitude qui brouille les pratiques,
détourne les procédures et les outils. Remise en cause des
habitudes constructives, détournement du cadre réglementaire,
subversion de formes convenues. Certains architectes démontent
les idées reçues de leur propre pratique et, par contamination,
portent un discours critique sur le monde contemporain : une contestation
brutale ou tout en douceur, qui peut prendre forme à la limite
de la légalité ou, au contraire, emprunter les chemins d'une
pratique pragmatique, et faire du dérisoire un outil positif.
•6)
Forme - Processus de création
Au-delà des problématiques de l'habitation, la forme ou
plutôt le processus de création reste, pour certains, la
préoccupation majeure dans la conception.
La forme peut être le résultat d'une manipulation technologique,
d'un choix de structure, de matériau, d'une manipulation du volume,
du plan, ou encore le produit d'un système qui s'autogénère.
L'architecture peut être issue du contexte, de territoires superposés
qui désorganisent la forme. Parfois elle intègre les effets
du temps, du climat et devient paysage.
>>retour
accueil
>>Scénographie
>>Manifestations associées
>>Tables rondes
>>Actions pédagogiques
>>Communication
>>Les informations pratiques